Jeremy Désir avait tout ce qu’il faut pour “réussir” : des grandes études, un bon poste bien payé en banque… mais tout cela, c’était avant le virage écologique. Sa lettre de démission fut une vraie source d’inspiration, avant que je ne prenne le même chemin quelques mois plus tard. Faut-il être un peu fou pour quitter ce chemin de la réussite et en emprunter un autre nécessairement plus compliqué ? Quelles sont ses motivations ? Comme l’indique son livre, doit-on réellement faire sauter la banque ?
Hello Jeremy ! Très heureux de pouvoir enfin échanger avec toi, sachant que tu as été l’une des inspirations de mon départ du monde de la finance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter et nous expliquer ton parcours avant la banque ?
Merci pour cette possibilité d’échanger Thomas. Sur mon parcours, il est celui d’un jeune à qui on a conseillé de faire de grandes études pour honorer ses facultés scolaires, notamment mathématiques. En septembre 2008, j’entrais en terminale au plus fort de la crise des subprimes, dont les scandales m’ont fortement marqué. C’est en classe prépa que j’ai deviné peu à peu la puissance politique immense de la finance. Je souhaitais alors intégrer ce milieu, comme scientifique, pour la réformer, l’humaniser, d’un point de vue rationnel — croyant, à l’époque, qu’il s’agissait juste d’un problème d’équations.
En 2013, j’intégrais les Mines de Saint-Etienne, une école d’ingénieurs, pour me spécialiser en data science (science des données), avant d’enchaîner avec un double diplôme en finance à Londres, où je fis mes armes en trading via un stage dans un hedge fund (fond spéculatif) qui venait d’empocher un beau pactole grâce au Brexit en pariant contre la livre. J’ai ensuite été accepté au master « El-Karoui », cohabilité par l’UPMC (Paris 6) et Polytechnique, qui forment les meilleurs quants (analystes quantitatifs), c’est-à-dire concepteurs ou contrôleurs de modèles mathématiques sur les marchés financiers. Après un dernier stage en 2017, chez Descartes Trading, filiale interne de la Société Générale à La Défense, caractérisée par des activités de « prop trading » (trading pour compte propre : consistant à prendre des positions de marchés avec les fonds de la banque et non pour le compte des clients), j’ai galéré près d’un an à trouver un job. Au moment où je n’y croyais plus, je reçus une offre de Londres, au siège de la plus grande banque d’Europe, HSBC, pour superviser leurs modèles de trading algorithmique haute fréquence.
Dans ton livre Faire sauter la banque, tu reviens très largement sur l’élitisme des grandes écoles d’ingénieurs, avec l’accent sur un métier perçu comme la Rolls-Royce du moment : le data scientist. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce métier ?
Le data scientist est à l’intersection des métiers de statisticien et d’informaticien. Il récupère des données numériques, parfois issues de différentes sources, sous différents formats, puis les harmonise et les nettoie pour s’adapter à un problème donné, comme prévoir un évènement ou catégoriser des objets. C’est là qu’il passe en revue les algorithmes — les modèles statistiques —, qu’il pense être appropriés, puis les confronte à son jeu de données. On appelle cette étape l’« apprentissage » (machine learning), comprenant des phases d’entraînement suivis d’une phase de test. Un peu comme des phases de cours, suivis d’examens notés, mais appliqués à une machine. Enfin, il arrive que le data scientist doive expliquer ses choix de modélisation à son supérieur, ou à son client, aux profils potentiellement moins techniques que le sien. Les facultés de communication sont donc appréciées.
Si ton problème de prévision concerne spécifiquement les marchés financiers, alors le métier de data scientist se rapproche, voire se confond, avec celui de quant.
Quel est le salaire d’entrée d’un data scientist ? Et ça va jusqu’à combien ?
C’est très bien payé. En France, on rentre sur le marché du travail autour de 45 000 € bruts annuels (3 000 € nets par mois), avec entre 10 et 20% d’augmentation par an. Dans la finance, plutôt à Londres, New-York ou Hong-Kong, au bout de trois, quatre ans un quant peut même toucher jusqu’à 200 000 € par an. Tu peux extrapoler la suite. Personnellement, HSBC m’a proposé 67 000 € bruts (4 000 € nets par mois), primes comprises, pour mon premier contrat permanent à Londres.
En ce moment, il est énormément question de banques éthiques : trouver la banque la plus éthique, la plus verte possible. Si tu devais citer la banque la moins éthique du monde, ça serait laquelle, et pourquoi HSBC ?
En effet, s’il y a bien une banque qui se surpasse dans ses opérations criminelles, c’est HSBC. Trois dates pour fixer les idées.

En 2012, la banque doit payer une amende record de $1,9 milliards pour non-respect des normes sur le financement du terrorisme et « blanchiment massif » de l’argent des cartels de drogue mexicains et colombiens. De 2006 à 2009, $10 milliards en liquide furent transférés de HBMX (la filiale mexicaine d’HSBC) à la maison mère aux États-Unis, sans le moindre contrôle, malgré les alertes répétées des régulateurs ; pour un total de $670 milliards non contrôlés, tous types de transferts confondus, et dont au moins $881 millions blanchis par deux cartels de drogue. Pire : sur la même période, HSBC transfère par virements bancaires non contrôlés aux USA, en provenance de ses filiales à travers le monde classées « risque faible » — comme le Mexique (!) — plus de $60 000 milliards par an… C’est l’équivalent du PIB mondial de l’époque. Sur ce volume hallucinant d’argent non surveillé, quelle fut la proportion d’argent sale ? Nul ne le saura probablement jamais. Ces sommes, partiellement (ou totalement ?) issues du crime organisé, doivent être mises en regard avec l’amende pénale de $1,9 milliards (10% des profits de la banque avant impôts en 2010) qui devient subitement ridicule. Les détails sont librement accessibles dans le rapport d’enquête du Congrès US, titré sans ambiguïté : « U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History ».
En 2015, la fuite des SwissLeaks révèle un système international de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, mis en place par HSBC depuis sa filiale suisse. Dans la liste des clients de la banque figuraient aussi le réseau des donateurs de Ben Laden, surnommée la « Golden Chain ». D’après le quotidien Le Temps : « Dans au moins trois cas, il s’avère que HSBC a poursuivi la relation bancaire avec des clients soupçonnés publiquement d’avoir financé le terrorisme ». Toujours grâce à ces révélations, Le Monde précise que la banque « a servi d’intermédiaire financier à des […] criminels qui ont alimenté et financé en Afrique des guerres parmi les plus sanglantes et des ventes d’armes parmi les plus immorales ».
Encore tout récemment, les « FinCEN Files » fin 2020 : avec $2000 milliards d’argent sale blanchis en moins de 20 ans, une poignée de banques ont permis à des réseaux mafieux, à des dictateurs, d’injecter leurs revenus illégaux dans le réseau financier légal mondial. Même après avoir été sanctionnées pour échecs antérieurs à endiguer les flux d’argent sale, 5 de ces banques — comprenant HSBC, évidemment — ont continué à transférer de l’argent pour des fraudeurs, des trafiquants de drogue et des fonctionnaires corrompus.
Des banques comme HSBC ne sont pas seulement « too big to fail » (trop grandes pour faire faillite) : elles sont trop grandes pour être contrôlées, c’est-à-dire « too big to jail (trop grandes pour la prison) ».
Si je comprends bien, la banque, ou les banques, n’ont pas les moyens de surveillance pour contrôler leurs activités de marché ?
C’est tout à fait ça. Comme ils sont largués, les États les laissent écrire leurs propres règles, mais les activités des banques dont on parle — les banques d’investissements, d’importance systémique — sont tellement vastes et sophistiquées qu’elles galèrent à se surveiller elles-mêmes ! Prenons le cas du trading algorithmique, et sa version sous stéroïdes appelée « trading haute-fréquence » (THF) —la vitesse d’une transaction étant de l’ordre du millième, voire du millionième de seconde… —qui est parfaitement symptomatique de la complexité des marchés. La validation de modèle, telle que pensée par et pour HSBC, peut prendre jusqu’à 6 mois par algorithme, et nous n’étions qu’une poignée dans toute la banque à connaître et comprendre ce code informatique traitant jusqu’au milliard de dollars par jour… Et il existe des centaines de modèles de ce genre, parfois modifiés toutes les semaines, en court-circuitant sciemment notre travail de validation car ce serait trop long d’être vraiment scrupuleux. Maintenant, multiplie par le nombre de banques, de fonds d’investissements…
Ainsi, bien qu’on parle d’une mission impossible, d’un fantasme, les États ne se donnent même pas les moyens de prétendre qu’ils surveillent les banques, en recrutant les mêmes armées d’ingénieurs, de scientifiques, en investissant dans les mêmes architectures numériques, antennes hautes-fréquences, fibres optiques, logiciels de calcul haute performance… pourtant essentiels aux activités de marché d’aujourd’hui. Ils ne se donnent pas non plus les moyens juridiques pour s’attaquer au problème — un procureur général de Genève parle d’un pouvoir de sanction financière de « très petit calibre » dans le droit Suisse, quand le Trésor des États-Unis assure avoir « fait le maximum » prévu dans leurs statuts concernant l’amende (ridicule) contre HSBC.
Enfin, il y a très peu de moyens humains, sachant que sanctionner les manipulations des cours d’un seul trader peut prendre 18 mois d’enquêtes (en 8 ans, le gendarme boursier français n’a dressé que 2 sanctions, l’une d’elle aboutissant sur une amende 60 fois plus petite que le profit réalisé par le trader qui — comble de l’ironie — opère toujours). Bref, le combat est perdu d’avance. En THF, comme plus généralement en trading, ou même en finance, il y a une véritable impuissance programmée : technologique, humaine, législative, du régulateur.
C’est l’impunité la plus totale. On peut aussi évoquer le « shadow banking », ce groupe d’intermédiaires financiers offrant des services similaires aux banques mais en dehors des réglementations bancaires standards. Selon le Conseil de stabilité financière, cette « banque de l’ombre » a atteint le niveau record de $184 000 milliards en 2017, soit 50% des actifs financiers dans le monde…
En somme, une situation révoltante qui n’est pas un oubli malencontreux des États mais un choix politique assumé, délibéré, criminel.
Parlons maintenant, si je peux l’appeler comme ça, de ton virage écologique. C’était quand exactement ? Dans ton livre tu évoques la démission de Nicolas Hulot et la sortie du Rapport Spécial du GIEC 1.5.
Ne connaissant rien à l’écologie, l’année 2018-2019 a été charnière dans ma prise de conscience, quand je venais tout juste de commencer chez HSBC. D’abord avec Nicolas Hulot, oui — dont j’ignorais le bilan mais qui semblait jouir d’une certaine crédibilité — et l’affront fait au gouvernement de sa démission surprise fin août. Dans les jours qui suivirent, en septembre, je tombais sur le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, lancé par des étudiants de grandes écoles et faisant état d’informations alarmantes que je lisais pour la première fois : décennie la plus chaude depuis deux siècles, feux de forêts inhabituels, désertification des sols, millions de personnes déplacées…
Encore quelques semaines plus tard, je fus touché par les ondes de choc quasi simultanées du mouvement des Gilets jaunes et des grèves scolaires pour le climat, qui attestaient selon moi, à différents degrés, d’un refus assumé de se soumettre à une loi, une organisation ou un pouvoir qu’ils estimaient injustes. Très vite, d’instinct, j’ai soutenu ces mouvements — en évitant bien sûr d’en parler au travail — qui m’attiraient par leur révolte spontanée. Ce fut également le cas pour Extinction Rebellion (XR), lancé en octobre, que je découvrais en avril 2019, grâce à leur perturbation de la station de Canary Wharf, deuxième plus grand quartier d’affaires de Londres, où HSBC et d’autres titans financiers tiennent le siège. Cette action de désobéissance civile, sous mes yeux, leur banderole « Climate emergency, act now (Urgence climatique, agissez maintenant) » à laquelle je ne comprenais presque rien, m’a interpellé au point de participer à ma première manifestation écologique.

Source : https://www.standard.co.uk/news/transport/extinction-rebellion-protesters-climb-on-top-of-dlr-train-at-canary-wharf-a4125746.html
Entraînés par une amie de ma compagne, venue de la branche écossaise d’XR, nous avons pris part au blocage du Parliament Square, devant le palais du Parlement au pied de Big Ben.
Ce jour-là, c’est grâce à un débat informel entre un jeune sympathisant XR et un passant sceptique qui venait d’interpeller sèchement notre groupe, que j’entendais pour la toute première fois parler du GIEC, du Rapport Spécial 1,5°C. C’est là, au milieu de militants qui bloquaient l’une des plus grandes artères de Londres, les mains collées au sol ou entrelacés les uns aux autres pour obstruer toute tentative de délogement policier ; que je touchais du doigt les tenants et aboutissants d’un certain point de basculement du climat chaotique, potentiellement atteignable dans la décennie. Je restais sans voix.
Comment se fait-il que dans des études aussi brillantes et pointues, on ne parle pas d’écologie ?
C’est une autre situation révoltante, que je décris comme un état d’ignorance programmé. Clairement, le changement climatique — ne parlons même pas de la biodiversité — n’a jusqu’à présent intéressé qu’une infime minorité de chercheurs en finance ou en économie. Par exemple, le Quarterly Journal of Economics, journal le plus cité en économie, n’a jamais publié sur le changement climatique. L’article d’Oswald et Stern (2019) qui le déplore donne une explication savoureuse : « Si peu d’économistes écrivent des articles scientifiques sur le changement climatique, c’est parce que les autres économistes n’écrivent pas d’articles sur le changement climatique ». Ce phénomène grotesque est similaire en finance, où sur les 20 725 articles publiés dans les 21 principales revues financières, entre 1998 et 2015, seuls 12 articles (0,06 %) sont liés d’une manière ou d’une autre à la « finance climatique (climate finance) ».
Puis cette recherche, aveugle aux enjeux écologiques, se diffuse partout dans les formations, en écoles d’ingénieurs, de commerce. Comment l’expliquer ? Je commencerais par répondre en notant que cet aveuglement de la finance et de l’économie n’est pas limité à l’écologie, et concerne plus largement leurs dimensions sociales. Dans son Nouveau capitalisme criminel (2014) — que je recommande vivement — Jean-François Gayraud, haut fonctionnaire de la police nationale, regrette que l’éclairage de ces disciplines par la criminologie ne soit prisé ni par les économistes, ni par les criminologues. D’après lui (p. 22), cet aveuglement profond est « d’abord intellectuel : nous ne savons ou ne voulons pas voir, par ignorance, cynisme ou calcul. Il est aussi parfois […] idéologique : une conception dogmatique du libéralisme qui tend à nier et à dissoudre le caractère corrosif du crime dans le fonctionnement des marchés […].
Au-delà de la seule doctrine libérale, c’est en réalité un large pan de la pensée économique classique qui, par un positivisme étroit, refuse de considérer le crime comme variable explicative pertinente. La plupart des économistes considèrent que la question criminelle ne les concerne pas. Le crime serait un acte neutre pour la compréhension des marchés, car son contenu serait essentiellement moral et juridique. [Or] la main du crime sur les marchés existe : elle n’est invisible que pour les économistes qui la nient. »
Je pense qu’on peut aisément transposer à l’écologie les raisons de ces impensés criminels de la finance, voire, plus largement, de toutes les études servant l’économie industrielle.
Est-ce que tu as le sentiment que les choses changent un peu depuis 2-3 ans ?
Il semble y avoir un peu d’agitation depuis 2-3 ans, en effet. C’est principalement grâce à la pression étudiante (les directions du supérieur n’y étant pour rien, quand elles ne sont pas carrément hostiles). Il ne va rien falloir lâcher car ces changements restent marginaux et évitent d’aller au fond des choses. Comme l’ont formulé 1000 étudiants et alumni de Paris-Dauphine dans une lettre ouverte : « Les 6h de finance responsable [i.e. de la croissance verte] sont vite oubliées lorsqu’elles sont suivies de 120h de finance irresponsable ». Les formations académiques, y compris scientifiques, sont loin d’être immunes aux opérations de comm’ et au greenwashing.
Raconte-nous la fin de ton aventure chez HSBC, et cette fameuse lettre…
Au printemps 2019, je commençais à combler mon ignorance écologique via des articles, vidéos, conférences, témoignages ; et décidais de traduire ces informations en actions. Après une étape nécessaire, mais négligeable, de « petits gestes » individuels, j’allais interroger mon angle mort écologique : mon travail. Sceptique face à la communication grandiloquente d’HSBC en matière de « finance verte », j’ai pris deux mois pour décortiquer, sur mon temps libre, toute leur documentation disponible sur le sujet. Cela n’avait rien à voir avec mon métier, rien ne m’y ayant incité, malgré la déclaration (non contraignante) d’une « urgence écologique et climatique » par le Parlement en mai. Et là, le fossé entre, d’un côté : l’état catastrophique du monde, réaffirmé depuis plus de 50 ans par des générations de scientifiques, d’écologistes, activistes et intellectuels ; et de l’autre : les « solutions » proposées par la sphère financière, avec la complaisance des superviseurs et banques centrales, m’a glacé le sang.
J’ai alors voulu restituer ce constat, exposer ces incohérences, et proposer plusieurs niveaux d’actions, selon moi plus prometteuses, ce qui a pris la forme d’un rapport à mes supérieurs. Leurs réactions, du relativisme au déni, m’ayant profondément déçu et choqué, j’étais incapable de perpétuer ce mensonge envers moi-même. Profitant d’un congé, le 29 juillet 2019 (jour mondial du dépassement), je rédigeais une lettre ouverte de démission, à l’intention d’une dizaine de médias. Mr Mondialisation fut le seul à la publier. En deux jours, 300 000 personnes touchées. Cette lettre m’offrit une tribune exceptionnelle pour dénoncer publiquement la propagande mensongère de mon employeur, le cynisme de mes supérieurs, la violence ignorante, sourde et aveugle de la finance, ainsi que son rôle capital dans l’écocide en cours.
J’imagine déjà connaitre ta réponse, mais selon toi, peut-on changer le système de l’intérieur, le reformer, ou il faut nécessairement agir de l’extérieur ?
On m’avait déjà prévenu pendant mes études que la finance était irréformable. Sans doute ces conseils n’étaient pas assez convaincants, ou bien avais-je besoin de me convaincre par moi-même… Donc, évidemment, il faut le répéter : « changer le système de l’intérieur » est impossible. C’est un mensonge dangereux, une fable persistante, suggérant qu’il n’y aurait qu’un problème d’individus, et non pas de structure au capitalisme. Qu’il arrive à ce dernier, par moment, d’être défectueux, mais qu’il est foncièrement bon pour la société, que les bonnes personnes l’ajusteront de manière optimale. Une perspective très libérale en somme, qui convient bien aux défenseurs du statut quo, à ceux qui en profitent.
Concernant la question d’une meilleure efficacité « dedans ou dehors », je pense qu’il faut d’abord savoir répondre à une question préliminaire, difficile mais centrale : que voulons-nous ? Ce n’est pas si évident qu’il n’y paraît. Les dirigeants et employés des grosses banques, des multinationales — certains « écolos » aussi, hélas — ce qu’ils veulent c’est faire de l’argent sans (trop) détruire la planète. Attention, c’est bien différent de vouloir sauver la planète, coûte que coûte, quitte à faire beaucoup moins (voire plus du tout) d’argent ! Si on est clairs sur ce qu’on veut, et qu’on préfère la deuxième option, comme c’est mon cas, il y a des actions intéressantes qu’on soit dedans (en faisant fuiter des informations sensibles, par exemple) ou dehors (en bloquant ou en sabotant une entreprise, en cultivant un jardin partagé, en soutenant des médias engagés dans la lutte…) pour faire tomber ce système tout en imaginant d’autres, à taille humaine. Et donc à terme, dans cette optique, il ne devrait plus y avoir de « dedans » du tout (rires).
Inversement, si on préfère la première option, c’est-à-dire qu’on n’a pas grand-chose à reprocher aux banques systémiques à part leurs émissions (indirectes) de CO2, qu’on juge leurs activités indispensables à l’organisation sociale de la planète, alors là aussi, il y a des choses à faire (selon moi nuisibles et contre-productives) « dedans ou dehors ».
Que penses-tu de l’ONG Reclaim Finance ?
Leurs rapports sur le financement aux énergies fossiles par les banques internationales sont intéressants, et peuvent être utiles pour argumenter plus largement sur le rôle de la finance dans le désastre écologique.
Concernant leur directrice générale, Lucie Pinson, qui a reçu le prix Goldman pour avoir incité des acteurs financiers à se désinvestir du charbon, je suis mitigé.
En écoutant ton entretien avec elle, j’ai apprécié qu’elle dénonce la minimisation éhontée des banques sur leur puissance politique, chose que j’avais entendu chez HSBC. Ces titans boursiers osent prétendre qu’ils seraient « neutres », malgré des opérations de lobbying intense auprès des ministères pour n’être ni régulés, ni sanctionnés (ou juste des amendes ridicules). Autre point d’accord quand L. Pinson concède n’avoir « pas plus confiance dans la capacité du gouvernement à réguler, que dans les acteurs financiers à s’autoréguler ». Terrible mais très juste.
En revanche, je ne la suis plus du tout quand elle annonce que son association « n’a pas pour but d’égratigner l’image des banques mais de les faire bouger [pour qu’elles] nettoient leurs financements », qu’elles devraient faire attention à ne pas perdre l’attractivité des jeunes diplômés. Ou encore, quand tu la lances sur l’impossible régulation bancaire et qu’elle répond : « la majorité de mon activité est liée à pousser des acteurs financiers à […] l’autorégulation tout en sachant que ça ne va pas suffire mais on pousse sur tous les fronts ». Est-ce à dire qu’il faille aussi pousser vers des impasses ? Faut-il laisser aux pyromanes le soin d’éteindre l’incendie ? Tout ceci risque d’entretenir une confusion malvenue.
Dans ton livre, tu as émis plusieurs critiques, notamment sur la collapsologie. Peux-tu nous dire pourquoi ?
Au cours d’une brève période « collapso » qui imprégna l’intention de mon rapport, c’est-à-dire en percevant l’effondrement rapide du système économique et financier comme une catastrophe plutôt qu’une solution, je pense être tombé sur deux écueils. Premièrement, bien qu’ayant pris la précaution de pas promouvoir les énergies dites « renouvelables » (EnR) financées à coup de milliards d’obligations « vertes » — qui n’ont de renouvelables ou de vertes que le nom — je n’avais pas assez insisté sur la fuite en avant qu’elles symbolisent. En effet, à l’instar de l’énergie nucléaire ou des barrages hydroélectriques, la « transition énergétique » par les EnR industrielles ouvre de nouveaux marchés « écologiques » qui doivent alimenter la croissance économique (comme démontré avec les rapports internes de finance durable d’HSBC, des banques centrales et superviseurs).
D’ailleurs, la croissance économique nécessite un réseau complexe d’infrastructures et de technologies, reposant sur une société hautement hiérarchisée avec d’importantes spécialisation et division du travail, organisées à l’échelle planétaire pour l’obtention des matériaux nécessaires à sa fabrication.
On en arrive donc au deuxième écueil, celui de l’absence de critique — voire de conflictualité assumée — envers l’organe qui a pour vocation de garantir et réguler (ou déréguler) par la force ce réseau constitutif de l’ordre économique : l’État.
La découverte d’un article de Nicolas Casaux : Le problème de la collapsologie, développant brillamment ces écueils, ainsi que quelques autres, a été essentielle dans ma prise de conscience écologique radicale (en prenant le problème à la racine).
Ces critiques ne sont pas forcément propres à la collapsologie, et pourraient sans doute s’adresser aussi à la plupart des mouvements sociaux, écolos ou décroissants.
Nous en avions discuté, il existe plusieurs mouvements dans la décroissance, dont un mouvement très critique de l’État et de son rôle. Peux-tu nous rappeler la définition de l’anarchisme ?
Le mot anarchisme (du grec an et arkhê) désigne l’absence d’autorité, de dirigeants. Au départ, comme beaucoup de gens, je pensais que c’était juste un synonyme de « bordel ». Puis, en diversifiant mes lectures, il m’a semblé clair que l’asservissement funeste du vivant, à l’origine du désastre écologique, a des racines communes avec d’autres formes de dominations, et qu’il existe donc des échelles de pouvoir et de responsabilités distinctes, entre pays ou individus. Or l’anarchisme, historiquement, c’est cet ensemble de pratiques et de théories politiques qui s’oppose à toute forme de domination. Les courants qui en héritent s’articulent donc principalement autour d’une critique du capitalisme (domination sur la propriété — avant d’être une dynamique de croissance infinie) ; de la religion (domination sur les consciences) et de l’État (domination sur les corps et le territoire). C’est aussi un mouvement qui, il y a plus d’un siècle, était déjà sensible aux droits des femmes, et les laissait prendre part à la vie politique.

Pour aborder cette histoire, cruellement absente de notre imaginaire politique, je ne saurais trop conseiller le documentaire « Ni Dieu, Ni Maître » de Tancrède Ramonet. Plus courtes, les vidéos de L’école du chat noir en offrent également une excellente introduction. Pour approfondir et se convaincre que l’humanité a vécu (très) longtemps sans État, il y a les travaux passionnants des anthropologues anarchistes James C. Scott, Marshall Sahlins ou David Graeber (créateur du concept de « Bullshit jobs », il fut l’une des principales figures du mouvement Occupy Wall Street).
L’anarchisme est selon moi une philosophie incontournable à l’appréhension des enjeux de notre époque.
Est-ce que tu te considères anarchiste ?
Après avoir mis beaucoup d’espoir dans le réformisme, ayant suivi de près les programmes politiques (souvent très à gauche) qui prétendaient lutter contre les injustices, je me suis rendu compte, par le prisme de l’écologie, que l’État — en tant qu’imposant système de domination — faisait partie du problème. Des monarchies de droit divin aux empires coloniaux, jusqu’à leurs déclinaisons modernes, les États n’ont jamais été au service des peuples, et n’ont fait que concentrer le pouvoir politique entre les mains d’un seul homme, ou d’une petite poignée, par l’usage de la « violence légitime ».
Ce à quoi j’aspire, c’est à la démocratie directe, c’est-à-dire, selon Francis Dupuis-Déri, « où tous les citoyens peuvent participer à l’assemblée où se prennent les décisions politiques collectivement et à la majorité ». Mieux, en ne cessant jamais de lutter contre les systèmes d’oppressions, j’aimerais œuvrer, d’un même geste, à créer ou me fondre dans une commune où « tous les membres peuvent participer directement au processus de prise de décision qui est délibératif et collectif ; et lors duquel sera recherché l’atteinte de consensus ».
En cela oui, je me considère anarchiste.
Pensant qu’une régulation des banques est impossible, tu as appelé à l’auto-démantèlement des banques. Sans me prononcer sur l’idée, tu sais bien que c’est impossible ?
Disons que selon moi, ce serait la seule stratégie honnête, souhaitable et même davantage possible que la croissance verte ou la régulation, dont les dirigeants des grandes banques disposent pour respecter l’Accord de Paris. C’est ce que j’avais suggéré durant mon témoignage, en janvier 2020, lors du procès de 12 militants pour le climat poursuivis pour avoir joué au tennis dans une succursale du Crédit Suisse à Lausanne. Nos trois témoignages — ceux de Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie ; de Sonia Seneviratne, professeure en climatologie à l’EPFZ, co-auteure du rapport spécial 1,5°C du GIEC ; et le mien — ont convaincu le juge, réputé conservateur, d’acquitter les prévenus en reconnaissant l’état de nécessité. Un « jugement historique » bien que seulement symbolique.
Suggérer un auto-démantèlement relevait de la provocation, destinée à briser un tabou, à élargir le spectre des stratégies imaginables (la fameuse fenêtre d’Overton), tant pour les militants, les avocats — agréablement surpris de m’entendre lâcher des idées si radicales, finalement utiles à leur défense — que l’opinion publique.
Et puis, si ces banques persistent à ne pas vouloir s’auto-démanteler, à préférer leur survie que celle d’écosystèmes viables (les deux n’étant pas compatibles), gageons que d’autres activistes, plus radicaux, leur donnent un coup de main.
L’Apartheid était légal, l’Holocauste était légal, l’esclavage était légal, la colonisation était légale… La légalité est une affaire de pouvoir et non de justice.
Quelle est ton actualité aujourd’hui ? Tes actions au quotidien pour l’écologie ?
Avec ma compagne Mathilde, ex-logisticienne au Programme Alimentaire Mondial (PAM) — l’organisme d’aide alimentaire de l’ONU — qui a traversé une désillusion similaire à la mienne l’an dernier, nous avons imaginé l’association : « Vous n’êtes pas seuls » (VNPS). Elle a pour but d’accompagner des salariés souffrant d’une fracture entre leur travail et leurs valeurs, accumuler des connaissances d’initiés sur les nuisances de leurs secteurs, diffuser les témoignages de leur rupture, tout en s’inspirant des initiatives prometteuses existantes.
En premier lieu, on écoute ces salariés en quête de sens, tout en les accompagnant pour qu’ils dressent un état des lieux sur les profondes injustices qu’ils rencontrent, puis qu’ils proposent un plan d’actions pour y remédier, échelonné par difficulté et, enfin, présentent le tout à leur hiérarchie. À ce stade, soit la hiérarchie décide de s’engager à son propre démantèlement (à sa décroissance, sa fermeture…), soit l’employé nous informe sur le point de blocage qu’il a rencontré et s’il le souhaite, nous l’aidons à lancer l’alerte.
Ce sont les grandes lignes d’une stratégie qui nous parle mais bien sûr, nous serions tout aussi intéressés par des personnes déjà convaincues de l’aliénation du salariat, et qui souhaiteraient rapidement quitter le navire (ou l’ont déjà fait !) avec panache.
Ce fut le cas de notre nouveau membre, Romain Boucher, camarade de lutte au soutien inestimable, ex-data scientist chez Sia Partners. Dans son témoignage de démission, diffusé début avril sous différents formats (vidéo, écrit, entretien), il expose brillamment les ravages du techno-libéralisme et le mythe du solutionnisme technologique. Grâce à Romain, des profils semblables au sien nous ont contacté, et la manœuvre nous a offert une exposition inédite.
Notre objectif étant la formation d’une opposition sérieuse aux destructions en cours, en jouant à la fois le rôle de média pour déconstruire les fausses solutions, mais aussi celui de réseau d’entraide, basé sur l’« archipélisation », en lien avec d’autres médias, réseaux militants et collectifs autogérés.
As-tu un conseil à donner aux lectrices et lecteurs de Bon Pote ?
Si malgré ce qui précède, celles et ceux qui te lisent rêvent de faire carrière en finance, je leur conseillerais… Oui, pourquoi pas ! Seulement à une condition : être conscients de l’échec programmé d’un quelconque « changement de l’intérieur », des démarches réformistes, et donc prêts à jouer un peu aux espions. Formez-vous au préalable à l’hacktivisme pour mieux vous protéger (sécurité numérique) et vous informer (investigation en ligne), via des plateformes comme la Communauté OSINT-FR ou Nothing 2 Hide.
Plus généralement, la première chose à réaliser pour résister, c’est faire le deuil des fausses solutions, promues en chœur par les États, multinationales et autres milliardaires, en traquant sans cesse ses angles morts, via la lecture de critiques sociales et politiques (bien trop dénigrées dans les parcours scientifiques). Notre génération se doit de contribuer à interrompre dès maintenant la course folle et destructrice de l’économie. D’un même geste, nous devrons réapprendre à vivre dans des sociétés à taille humaine et dans cette optique, les expériences en éco-villages, fermes ou jardins partagés (grâce au woofing par exemple), sont inestimables. Combinant actions et réflexions, tant politiques qu’agro-écologiques, les ZADs ont besoin de tout notre soutien !
Il y a des milliers d’alternatives à la civilisation industrielle capitaliste. Puisse notre génération se pencher de toutes ses forces, de tout son cœur sur la question.
Aux révoltés solitaires : vous n’êtes pas seuls !
















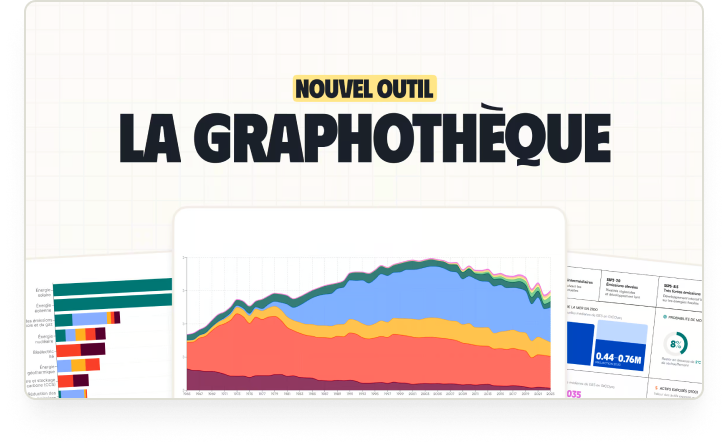
6 Responses
Je me demande si la prise de conscience de Jeremy pourrait être généralisable?
La question sous jacente est celle des ressources psychologiques dont disposent les individus.
Et de celles qu’il leur faudrait acquérir pour remettre en cause leur adhésion au système, ou du moins, à son fonctionnement actuel.
Dans l’exemple de Jeremy, il dit lui même qu’il était fortement touché par la prime des subprimes et qu’il partait d’une motivation de trouver l’équation qui lui permettrait de changer le système. Je trouve sa motivation initiale extrêmement pertinente.
En effet, si l’ensemble des décideurs de notre société étaient informés du problème, conscients d’une la nécessité d’un changement, et (on peut rêver) disposaient de la motivation nécessaire pour réaliser une rupture dans leurs habitudes de vie, (dans le sens d’une diminution du bénéfice immédiat lié à l’assistance techno-energétique): et bien, il me semble que l’on ne serait pas loin du but.
Il faudrait donc qu’un maximum de Jeremy atteignent les postes clés administratifs, civils, politiques et financiers
Manque plus que des outils de persuasion à la hauteur des enjeux. On y travaille. https://alter.pub
C’est sûr, c’est d’la bombe ! Enfin, je parle de la première partie. Après, le choix de l’anarchie est du ressort de la liberté de chacun.
En fait, on voit bien que le genre humain est à un grand carrefour, et il est vraisemblable que cette situation absolument inédite d’un danger planétaire que l’on voit venir, finisse par sacrément diviser le peuple.
Autant de “solutions” ou de “postures” ou de choix politiques qui risquent de finir dans le chaos ou le désordre qui n’auront rien à voir avec l’anarchie.
Reste à savoir si le monde imaginé par Jérémy Désir ou Etienne Chouard, ou d’autres, est effectivement viable : ce qui suppose une sacré dose d’éducation pour que chacun puisse se positionner sur tous les sujets de façon pertinente. Les systèmes d’aujourd’hui, quels qu’ils soient, reposent tout de même tous sur le fait que 80% de la population est réputée hors de portée de toute réflexion, en délégant aux 20% restants, censés apporter la juste parole…
Merci pour cet entretien !!
Bordel ça fait du bien de lire ça ! Un grand merci à vous deux !
Merci pour ce témoignage magnifique. Ce qui est précieux et rare ce sont vos chemins, d’un extrême à l’autre, vos conversions suite à vos prises de consciences.
Les défenseurs de ce monde en perdition sont très nombreux, il va falloir être forts.