|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Par Anne Stevignon (Juriste chez Notre Affaire à Tous), Marcellin Jehl (Juriste chez Les Amis de la Terre France) et Apolline Cagnat (Juriste chez Greenpeace)
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 23 octobre 2025 une décision historique : à l’issue d’une bataille judiciaire de plus de trois ans, il a condamné TotalEnergies, le champion français du pétrole et du gaz, pour pratiques commerciales trompeuses.
Cette décision historique fait suite à l’action en justice initiée en 2022 par Les Amis de la Terre France, Greenpeace France et Notre Affaire à Tous, avec le soutien de ClientEarth.
En 2021, le géant pétrolier français orchestrait son changement de nom de “Total” à “TotalEnergies”, en déployant un large arsenal publicitaire sur son site internet, les réseaux sociaux et dans l’espace public. L’entreprise y mettait notamment en avant auprès des consommateurs son “ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050” et revendiquait “être un acteur majeur de la transition énergétique”.
Des allégations trompeuses compte tenu du fait que les énergies fossiles représentaient encore la majorité écrasante de la production énergétique globale de l’entreprise et les trois quarts de ses investissements. TotalEnergies prévoit par ailleurs d’augmenter sa production de pétrole et de gaz de près de 3 % par an d’ici 2030, faisant de l’entreprise un acteur majeur de l’expansion fossile.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 a :
- déclaré que TotalEnergies avait commis des pratiques commerciales trompeuses, jugeant que certains messages relatifs à ses engagements climatiques étaient “de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements environnementaux du Groupe” ;
- ordonné au groupe de cesser la communication des messages concernés de son site dans un délai d’un mois sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
- ordonné la publication du jugement sur son site internet pendant 180 jours sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
- reconnu le préjudice moral causé aux intérêts collectifs défendus par les associations.
C’est la première fois à travers le monde qu’une major pétro-gazière est condamnée par la justice pour avoir trompé les consommateurs en verdissant son image concernant sa contribution à la lutte contre le changement climatique.
Les points clés du jugement
Le recours portait sur un ensemble d’allégations environnementales formulées par TotalEnergies à partir de mai 2021 et dont la diffusion auprès des consommateurs se poursuit en partie à ce jour. En particulier, l’action en justice visait certaines communications de TotalEnergies concernant :
(i) son rôle “majeur” dans la transition énergétique et son “ambition de neutralité carbone” ;
(ii) le gaz fossile présenté comme une énergie “propre” et “complément indispensable des énergies renouvelables” ;
(iii) les agrocarburants, présentés comme une solution exagérément vertueuse pour le climat.
Le tribunal devait donc se prononcer sur le point de savoir si ces allégations étaient trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation issus de la transposition de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales trompeuses.
Le tribunal a tout d’abord dû se prononcer sur le caractère commercial des allégations visées. En effet, pour être considérées comme commerciales, les communications de l’entreprise en cause doivent être “en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs”. Le tribunal a ensuite pu examiner le caractère trompeur des messages commerciaux en cause, et leur impact sur le comportement des consommateurs.
Les allégations relatives à la neutralité carbone
Les juges ont considéré qu’une partie des allégations relatives au climat étaient bien des pratiques commerciales. Les juges ont ensuite relevé que, par ses allégations, TotalEnergies “exprime clairement qu’il s’engage dès à présent, dans une démarche positive sur l’environnement”.
Une partie du débat devant la juridiction s’est cristallisée autour de l’analyse de la notion de “neutralité carbone”, revendiquée par TotalEnergies dans ses communications. Selon les associations, tout engagement à respecter la neutralité carbone d’ici 2050, aux termes de l’accord de Paris, ne saurait être compatible avec le développement continu des énergies fossiles.
Le tribunal a donc analysé l’état de la science (les travaux du GIEC, les publications de l’Agence internationale de l’énergie sur le scénario “Net zéro d’ici 2050”et les recommandations du groupe d’experts internationaux mandatés par le secrétaire Général de l’ONU notamment) pour dégager l’existence d’un consensus scientifique sur l’incompatibilité de l’expansion fossile avec la neutralité carbone, au sens de l’accord de Paris. Ce faisant, le tribunal a reproché à Total de se référer à la notion de neutralité carbone “sans préciser aux consommateurs qu’il avait son propre scénario […] consistant notamment à rendre compatible avec son ambition de neutralité carbone, la poursuite de ses investissements dans le pétrole et le gaz, à rebours des préconisations des travaux scientifiques alignés sur l’Accord de Paris.”
Notons que ce développement du tribunal quant à l’incompatibilité de l’expansion fossile avec les travaux scientifiques et les préconisations institutionnelles est historique et devrait avoir des implications dépassant le droit de la consommation.
Le tribunal a ensuite considéré que “ces allégations ont manifestement altéré, de manière substantielle, le comportement économique d’un consommateur normalement attentif et avisé dont le choix […] intègre de plus en plus les qualités environnementales du produit ou du service”.
On note que certaines précautions de TotalEnergies dans ses communications n’ont, semble-t-il, pas trompé la vigilance du tribunal. L’entreprise avait notamment pris soin de qualifier d’“ambition” son action pour atteindre la neutralité carbone. Mais le tribunal souligne que ce terme s’apparente en réalité pour le consommateur à un “engagement”, trompeur donc.
TotalEnergies assurait aussi effectuer cette transition “ensemble avec la société” – autrement dit, en s’alignant sur le rythme supposé de la demande en pétrole et en gaz. Mais cette formulation équivoque s’est finalement retournée contre TotalEnergies. Le Tribunal en a déduit que les communications de l’entreprise faisaient référence à la neutralité carbone mondiale telle que visée par l’Accord de Paris, et non à une neutralité limitée au périmètre de ses propres activités.
Les allégations relatives au gaz fossile et aux agro-carburants
Les associations requérantes visaient également des messages de TotalEnergies relatifs au gaz fossile et aux agro-carburants, qui promouvaient notamment le gaz fossile comme une énergie “de transition” “indispensable” et “fantastique” pour décarboner.
Les associations soulignaient, au contraire, que le gaz fossile et notamment le gaz naturel liquéfié (GNL), peut émettre davantage que le charbon sur l’ensemble de son cycle de vie, en raison des fuites de méthane[1].
Dans sa décision, le tribunal écarte néanmoins les messages relatifs au gaz fossile, estimant qu’ils relevaient d’une simple communication à visée “informationnelle” et ne pouvaient, à ce titre, constituer des pratiques commerciales au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Le tribunal, ayant écarté ces allégations, ne s’est donc pas prononcé sur leur caractère éventuellement trompeur. Pourtant, la nature commerciale de ces communications relatives au gaz faisait peu de doutes et sous couvert d’informer son audience, une entreprise peut parfaitement promouvoir un produit auprès des consommateurs. En l’occurrence, TotalEnergies avait publié ces communications sur ses réseaux sociaux – achetant même peut-être des espaces publicitaires pour les promouvoir – et les qualificatifs utilisés pour promouvoir le gaz, énergie centrale dans la stratégie d’entreprise de Total, notamment en France, semblaient confirmer le caractère promotionnel de ces communications.
Pour les associations requérantes, il en était de même s’agissant des allégations de TotalEnergies relatives aux agrocarburants : l’entreprise affirmait en effet que ces carburants permettent de réduire les émissions de CO₂ de “50 à 90 %” par rapport à leurs équivalents fossiles. De la même manière, le tribunal n’a pas qualifié ces pratiques de commerciales. Pourtant, comme pour le gaz fossile, ces messages avaient fait l’objet d’une promotion par le groupe sur ses réseaux sociaux et se rapportaient expressément à des produits proposés par TotalEnergies aux consommateurs.
NEWSLETTER
Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.
+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS
Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.
La réaction de TotalEnergies
Dans sa “mise au point” en réaction au jugement, TotalEnergies a annoncé ne pas faire appel du jugement, prenant “acte de la décision du tribunal judiciaire de Paris”.
La société y défend également sa stratégie climatique et affirme à 11 reprises sa “fierté” d’être un acteur “multi-énergies” et de produire – on le sait, majoritairement – du pétrole et du gaz.
Il est pour le moins étonnant que l’entreprise se félicite ainsi de participer à l’expansion fossile en réaction à un jugement ayant justement sanctionné des communications faisant état d’une stratégie climatique “à rebours des travaux scientifiques alignés sur l’Accord de Paris”.
Selon des données inédites rendues publiques ce jour par une coalition d’ONG, TotalEnergies est la pétro-gazière qui a le plus grand nombre de nouveaux projets fossiles, devant la compagnie nationale chinoise, Eni, BP et Shell. Elle est associée à non moins de 30 “bombes carbones” (contre 23 il y 2 ans) représentant à elles seules 70 gigatonnes de CO₂, soit plus de la moitié du budget carbone mondial restant pour limiter le réchauffement à 1,5 °C[2]. Au-delà des effets dévastateurs de ces projets pour les populations affectées, comme en Ouganda, en Tanzanie et au Mozambique, il ne fait donc aucun doute que TotalEnergies n’est pas un acteur en transition, bien au contraire.
Dans sa réaction au jugement, l’entreprise se targue pourtant “d’avoir déjà investi plus de 20 milliards € dans les énergies bas-carbone dans le monde depuis 2020”.
TotalEnergies tente ainsi de masquer son expansion fossile par ses investissements dans les énergies renouvelables, toujours exprimés en valeur absolue et non en proportion de l’ensemble de ses activités. Il s’agit d’une manœuvre classique de désinformation, qui crée l’illusion d’une sortie progressive des énergies fossiles, alors que le volume de pétrole et de gaz produit continue d’augmenter. La motivation du jugement est limpide sur ce point : le développement de nouvelles capacités fossiles est incompatible avec la notion même de transition, qu’importe le développement d’énergies renouvelables en parallèle.
Une publication scientifique récente dans la revue à comité de lecture Nature Sustainability met en lumière un chiffre éloquent : à peine 1,59 % de la production d’énergie primaire de TotalEnergies provient de sources renouvelables. En d’autres termes, l’écrasante majorité de l’énergie produite par TotalEnergies provient encore des énergies fossiles, à rebours de ses communications dominées par les énergies renouvelables et le climat.
Cette proportion ne semble pas être en voie d’évoluer dans un futur proche. Dans sa nouvelle “Stratégie et Perspectives 2025” présentée fin septembre, TotalEnergies a annoncé à ses investisseurs un plan d’économies de 7,5 milliards de dollars sur la période 2026-2030 qui concerne en premier lieu les investissements bas carbone : TotalEnergies a en effet indiqué vouloir concentrer ses investissements sur les projets “à forte marge” dans l’exploration-production de pétrole et gaz et “rester sélectif sur les investissements bas carbone”. Le géant pétro-gazier français a également annoncé vouloir augmenter sa production de pétrole, gaz et électricité d’environ 4 % par an jusqu’en 2030 et continuer l’exploration.
Les suites de l’affaire
La décision rendue marque un tournant décisif dans la lutte contre le greenwashing. Elle aura des répercussions bien au-delà de cette affaire.
Une incidence majeure sur la manière dont les entreprises formulent et définissent leurs ambitions climatiques
Ce jugement établit un lien clair entre l’état du consensus scientifique en matière climatique, la réalité des activités de l’entreprise, et l’incohérence éventuelle avec les messages diffusés auprès des consommateurs. Le décision devrait donc avoir une incidence notoire sur les secteurs les plus émetteurs, et notamment le secteur pétro-gazier, dont la crédibilité des stratégies climat – si elles existent – seront aussi scrutées à l’aune du droit de la consommation. Cette décision s’inscrit d’ailleurs dans le contexte d’une multiplication des contentieux climatiques : selon le dernier rapport sur le contentieux climatique publié par le PNUE et le Sabin Center for Climate Change Law, plus de 100 affaires de climate-washing ont été introduites depuis 2009.
Une décision importante pour les consommateurs face aux incertitudes européennes
Ce jugement intervient aussi dans un contexte dégradé au niveau européen, alors que sont menacées certaines évolutions en matière de protection des consommateurs face aux allégations environnementales trompeuses. En juin dernier, la Commission européenne annonçait un possible retrait de sa proposition de directive “Green Claims” destinée à davantage encadrer ces pratiques, sans que son sort soit, à ce jour, définitivement fixé. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris rappelle aux acteurs économiques que le droit en vigueur permet déjà de sanctionner un certain nombre de pratiques trompeuses en matière climatique.
La nécessaire et complémentaire régulation des communications institutionnelles
Ce jugement ne signifie pas que les seules communications aux consommateurs sont protégées contre le greenwashing. Dans son communiqué, TotalEnergies se félicite que ses communications “institutionnelles” n’aient pas été considérées comme des pratiques commerciales. Mais le tribunal a pris soin de préciser que la mise en ligne de communications sur un site non-marchand n’exclut pas, en elle-même, la possibilité qu’elles puissent être considérées comme des pratiques commerciales (le cas échéant trompeuses).
Les entreprises seraient donc bien inspirées de revoir l’entièreté de leurs communications publiques en matière climatique, au-delà de leur seuls sites marchands. Par ailleurs, les communications institutionnelles sont également réglementées contre le greenwashing climatique. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et les actionnaires doivent donc prendre leurs responsabilités et questionner la légalité des communications qui tomberaient en dehors du champ du droit de la consommation.
Au tour de l’AMF d’agir
Plusieurs signalements ont déjà été transmis à l’AMF en lien avec la stratégie climatique et les communications institutionnelles de TotalEnergies. Le 28 mai 2020, Notre Affaire à Tous et Sherpa ont ainsi déposé un signalement auprès de l’AMF, dénonçant “des omissions, inexactitudes et contradictions de l’information financière de Total, concernant en particulier les risques financiers liés à la transition énergétique”. En novembre 2022, Greenpeace faisait de même s’agissant de l’empreinte carbone réelle de TotalEnergies et sa communication trompeuse sur ses engagements net zéro 2050. En novembre 2023, c’est un collectif d’actionnaires de l’entreprise qui demandait à l’autorité de se prononcer sur le versement de dividendes fictifs du fait de l’insuffisante prise en compte du coût carbone sur l’ensemble des énergies fossiles extraites par le pétrolier. Ce collectif soutient, en conséquence, que les comptes publiés par TotalEnergies sont insincères.
La question des partenariats institutionnels
Alors que le greenwashing de TotalEnergies est désormais reconnu par la justice, se pose la question de la position qu’adopteront les institutions éducatives, culturelles, sportives ou scientifiques actuellement en partenariat avec cette entreprise et qui participent à embellir son image sur le plan environnemental. Des établissements prestigieux, comme le Collège de France, acceptent aujourd’hui d’associer leur image à celle d’un acteur qui n’est pas reconnu comme aligné avec la transition écologique. Ces partenariats ne sont pas neutres : ils contribuent à légitimer un discours et une stratégie qui ont été jugés trompeurs.
Face à l’urgence induite par l’aggravation du réchauffement climatique, les entreprises fortement émettrices comme TotalEnergies ne peuvent plus prétendre être des acteurs sincères de la transition énergétique. Le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une brèche en interprétant le droit de la consommation à la lumière du dernier état de la science climatique. Il appartient aux institutions, régulateurs et autres investisseurs de poursuivre cet effort collectif visant à lutter contre la désinformation environnementale et, en particulier, concernant l’expansion des énergies fossiles.
[1] R.W. Howarth, « The greenhouse gas footprint of liquefied natural gas (LNG) exported from the United States », Energy Science & Engineering (2024).
[2] Le budget carbone restant pour avoir 50% de chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C a récemment été évalué à 130 gigatonnes de CO2, source : climatechangetracker.org.






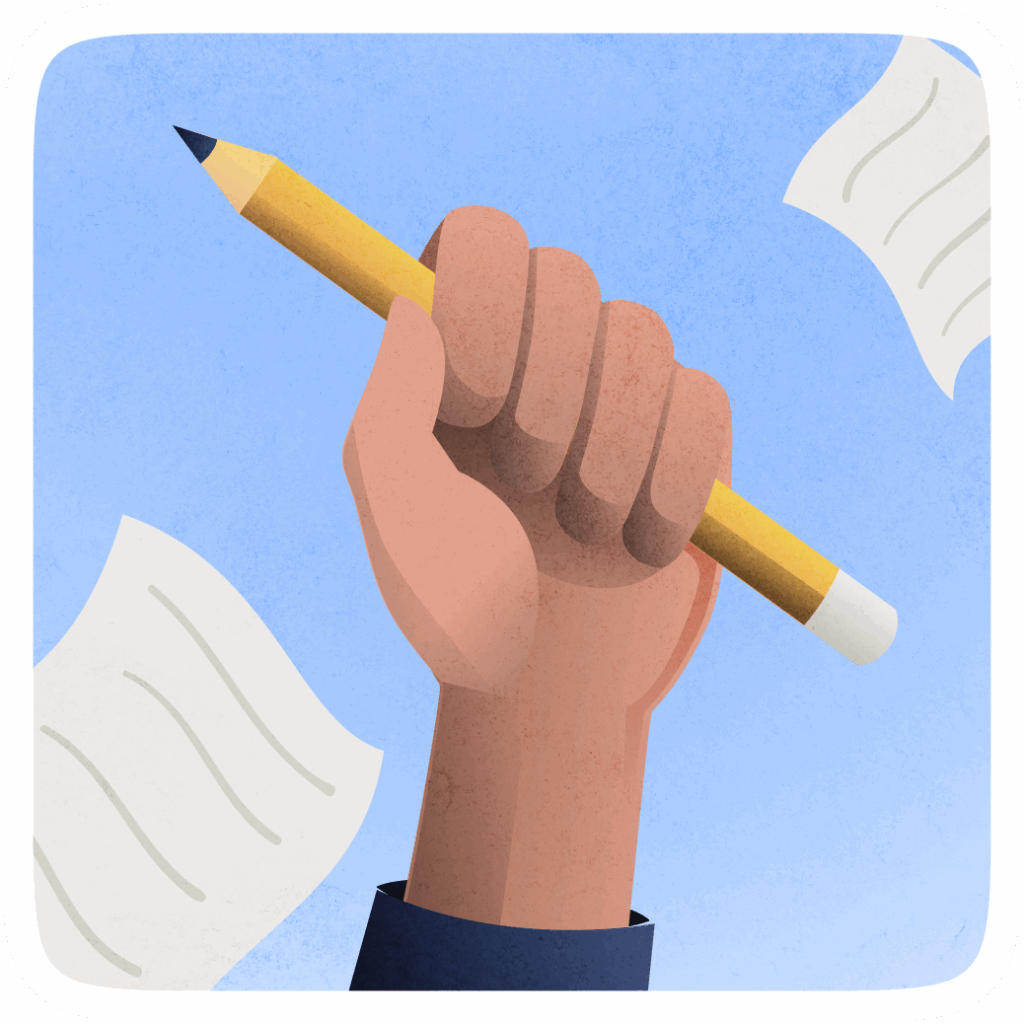

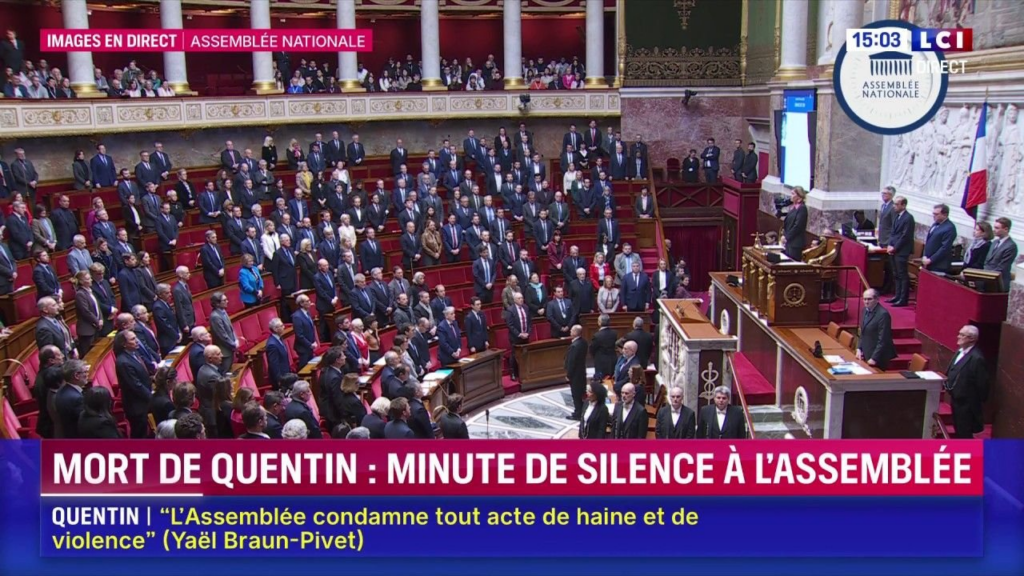







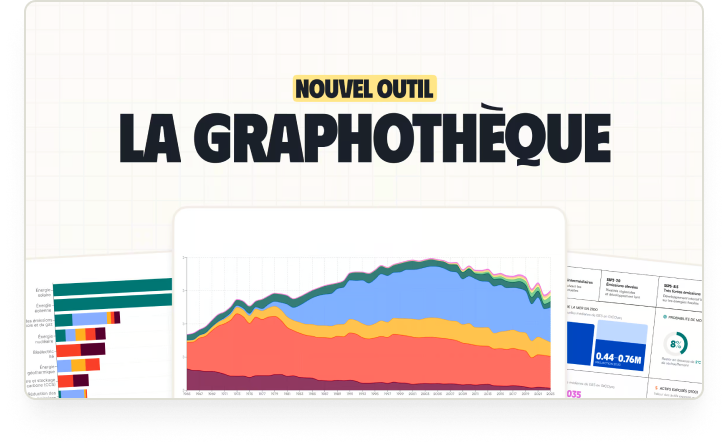
One Response
Je veux lire les articles et non pas les écouter.