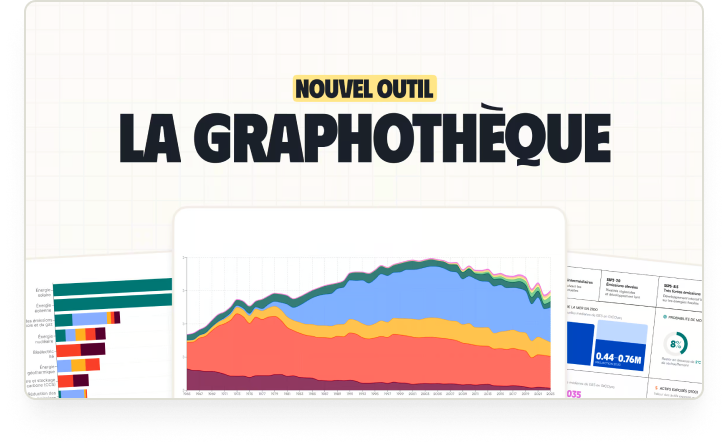|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La transition énergétique n’est pas d’abord une affaire de technologie ou de comportements individuels. C’est une affaire de contrôle. Contrôle des ressources, des brevets et des infrastructures énergétiques. Selon qui les possède, l’énergie peut être un outil de domination ou d’émancipation. C’est ce que nous apprend l’histoire longue de l’énergie, que j’analyse dans Énergie et inégalités : Une histoire politique (Seuil, 2025).
Le début de l’année 2026 nous le rappelle, à sa manière, avec une brutalité certaine. Dans un tel contexte, si la France et l’Europe veulent éviter la vassalisation énergétique, elles doivent désormais décarboner leur économie à toute vitesse. Pour cela, il leur faut un outil capable d’investir et de posséder les actifs stratégiques du XXIe siècle, à travers un fonds souverain de la transition écologique. Voici pourquoi.
Le retour sans complexe de l’impérialisme énergétique
Vous avez peut-être entendu parler de Peter Thiel. Investisseur influent et actionnaire clé de Palantir, au cœur de l’appareil sécuritaire états-unien, il défend une vision du capitalisme où l’État protège quelques géants privés au nom de l’efficacité et de la propriété de quelques-uns. Cette logique n’a rien de nouveau : dans L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine en analysait déjà les ressorts — concentration du capital, appui de l’État et expansion territoriale. Aujourd’hui, ces mécanismes s’appliquent au pétrole, aux matières premières critiques et aux technologies numériques.
L’intervention américaine au Venezuela l’illustre parfaitement. Le pays concentre environ 300 milliards de barils de pétrole, soit les plus grandes réserves prouvées au monde, que les multinationales américaines savent retraiter dans leurs raffineries du golfe du Mexique. L’enjeu principal est bien le contrôle de ressources énergétiques pour les décennies à venir, dans un contexte de hausse du coût d’extraction des hydrocarbures étatsuniens.
Le Groenland s’inscrit dans la même logique : celle d’un impérialisme vorace en ressources. Donald Trump revendique le contrôle des routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique et des ressources d’un territoire qui concentre 43 des 50 matières premières critiques jugées essentielles par l’administration américaine. Leur exploitation ne serait pas viable économiquement ? Trump a bien compris que les prix de marché ne sont qu’une petite partie des décisions d’investissement en matière d’énergie et de ressources vitales : it’s politics, stupid.
Sous ses airs burlesques et ses contradictions permanentes, le président américain offre donc une cohérence redoutable : déni climatique et capitalisme d’État au service de ses intérêts et de ceux de ses vassaux. Et pour maintenir l’adhésion de sa base électorale, là où les dividendes du pétrole ne suffiront pas, sa méthode est vieille comme le monde : opposer les natifs aux étrangers. Le projet de l’extrême droite américaine pour le XXIᵉ siècle est on ne peut plus clair : un impérialisme techno-carboné, autoritaire et xénophobe.
NEWSLETTER
Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.
+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS
Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.
Face aux États-Unis et à la Chine, l’Europe n’a pas encore trouvé sa voie
En matière de ressources, l’autre superpuissance mondiale a fait un choix radicalement différent. Disposant de peu de pétrole sur son sol, la Chine a misé dès les années 1980 sur les renouvelables puis sur l’électrification, appuyée sur la planification industrielle. Les résultats sont spectaculaires.
En 2025, la Chine a installé plus de capacités solaires que le reste du monde réuni. Pour la deuxième fois depuis plus de quarante ans, sa production d’électricité à partir du charbon recule, et 2026 pourrait marquer le pic de consommation de charbon chinois, condition du pic mondial.
Beaucoup expliquent ce succès par l’hyperconcentration du pouvoir politique en Chine. Cette dimension soulève évidemment des enjeux démocratiques fondamentaux. Mais elle n’est pas déterminante pour comprendre la dynamique industrielle à l’œuvre dans le secteur énergétique. Cette dynamique repose sur des instruments bien connus en Europe entre 1945 et 1980, et donc en démocratie : planification, investissement public, crédits à taux préférentiels, économie mixte combinant pilotage politique et concurrence organisée.
Entre l’impérialisme fossile américain et la planification à la chinoise, l’Europe, comme le Sud global, est aujourd’hui vassalisée. Nous dépendons du gaz américain et des brevets chinois sur les technologies électriques. Nos marchés de l’énergie ont été dérégulés et nos infrastructures partiellement privatisées au cours des quatre dernières décennies, ce qui limite la capacité des puissances publiques à piloter une transition de long terme.
Surtout, l’Europe accuse un déficit d’investissement dans la transition de l’ordre de 2 à 3 % de son PIB, soit 400 à 600 milliards d’euros par an (et autour de 90 milliards d’euros par an en France), dans la production d’énergies décarbonées, le stockage, la distribution, les transports et la rénovation thermique. D’aucuns diront que l’Europe n’a pas les moyens de son ambition en matière climatique et industrielle. Il faut ici sortir des idées reçues et de la sinistrose ambiante. L’Europe n’a jamais été aussi riche. Mais elle n’investit pas au bon endroit.
D’une part, l’Union Européenne importe de l’ordre de 350 milliards d’euros par an de d’hydrocarbures du reste du monde. D’autre part, 300 milliards d’euros d’épargne européenne atterrissent chaque année… aux États-Unis. Dit autrement, nous disposons des ressources nécessaires pour investir massivement dans la transition, qui nous permettra en retour d’économiser des sommes colossales. Mais nous n’avons pas aujourd’hui les bons outils.
En matière de financement de la transition énergétique, la stratégie européenne a jusqu’ici largement reposé sur le « dérisquage » : mobiliser l’épargne privée en réduisant le risque pour les investisseurs. En pratique, la puissance publique assume le risque, tandis que le secteur privé conserve la décision et empoche, quand tout va bien, les bénéfices. Ce modèle peut fonctionner dans certains secteurs. Mais dès lors qu’il remplace une stratégie d’investissement public, il atteint ses limites pour financer, à grande échelle et sur le long terme, des infrastructures et des capacités industrielles à rentabilité lente et incertaine (comme des champs d’éoliennes), ou des projets stratégiques et innovants.
Prenons un exemple emblématique de ces limites. Northvolt, jusqu’à l’an passé fleuron européen de la batterie, a déposé le bilan. Malgré un soutien public important, l’Europe n’a ni sécurisé l’investissement collectif, ni conservé le contrôle de l’actif stratégique : la plus grande usine européenne de batteries électriques a finalement été rachetée par une firme états-unienne.
Reprendre le contrôle du capital de la transition
La question n’est donc pas seulement d’investir davantage, mais de savoir qui investit et qui possède les entreprises clefs de la transition. En la matière, l’Europe et la France ont démontré au XXe siècle que la puissance publique pouvait intervenir dans le secteur énergétique avec succès. Le 8 avril 2026, nous fêterons les 80 ans de la nationalisation d’EDF-GDF. En Suède, ce sont les communes qui sont largement propriétaires des réseaux et centrales de chaleur. Les tarifs appliqués aux usagers, les décisions d’investissement, et le partage de rentes sont ainsi décidées de manière démocratique – pas par des puissances étrangères ou par de grands actionnaires privés. Cette histoire énergétique montre qu’une autre voie est possible. Elle passe par la reprise en main collective des investissements et des infrastructures de la décarbonation.
Concrètement, la création d’un fonds souverain de la transition écologique permettrait d’accélérer la transition en combinant investissement public, propriété des actifs et pilotage stratégique. Il s’agit d’un instrument capable d’investir en capital dans les industries et infrastructures stratégiques, de détenir des actifs publics durables plutôt que de subventionner à perte, d’orienter les investissements de long terme et de générer, puis redistribuer, les rendements de la transition.
Le fonds pourrait détenir directement des entreprises à l’échelle nationale (voire multiétatique) ou accompagner l’investissement des collectivités locales, communes ou régions, comme cela existe déjà dans plusieurs pays européens. Les acteurs publics de l’énergie ont en effet la capacité de combiner pilotage économique et objectif clé de sobriété énergétique. Cette articulation est difficile à atteindre lorsque les entreprises sont contrôlées par des acteurs privés orientés vers la rentabilité de court terme.
Le financement d’un tel fonds doit reposer sur deux piliers : des recettes fiscales nouvelles et une capacité d’endettement. Côté recettes, il est logique de s’appuyer sur ce que la transition doit précisément dépasser : les rentes pétrolières et la concentration extrême du capital. À l’échelle européenne, ces prélèvements peuvent rapporter en première approximation au moins 100 milliards d’euros par an. Adossées à ces recettes, une émission de dette permettrait de porter la capacité d’investissement du fonds à environ 200 milliards d’euros par an au niveau européen— un volume déjà considérable et qui pourrait être accru.
Ce fonds pourrait être impulsé par quelques pays européens (Espagne, France, Suède et Allemagne, par exemple), qui ont tout intérêt à mettre en commun une taxe sur les grandes fortunes, ainsi que leur dette (pour réduire le taux d’emprunt) et certains investissements stratégiques (comme les pays européens l’ont fait avec Airbus à ses débuts). Mais un tel fonds a aussi son intérêt dans un seul pays, à commencer par la France.
De toute évidence, récupérer 100 milliards d’euros aux plus hauts patrimoines européens et aux entreprises les plus polluantes, n’est pas une mince affaire. Il n’y a en la matière aucune formule magique. Cela exige d’assumer des rapports de force. Là encore, l’histoire énergétique peut nous éclairer : la nationalisation de l’énergie de l’après-guerre a été âprement combattue par les actionnaires qui s’estimaient alors expropriés. Il en va de même pour l’impôt exceptionnel sur le patrimoine de 1945 (qui taxait les plus hauts patrimoines français à hauteur de 20% pour investir dans la reconstruction). Face au chaos du monde, la France et l’Europe doivent relire leur propre histoire économique.
Disons-le clairement: si l’on estime qu’il est impossible de taxer les plus hauts patrimoines sans les faire partir, ou de contraindre TotalEnergies à payer davantage d’impôt sur ses bénéfices, alors autant abandonner notre souveraineté, et laisser brûler la planète. Pour paraphraser la formule popularisée par le philosophe Slavoj Žižek, le drame de notre époque est qu’il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Du reste, notre proposition est tout à fait modérée dans la mesure où elle s’inscrit dans une logique « d’économie mixte », mise en œuvre en Europe de l’Ouest dans les années 1945-1980. Elle ne transformerait pas moins les rapports entre puissance publique et marchés et contribuerait donc à transformer le système économique existant. C’est d’ailleurs pour ces raisons que les communistes et les gaullistes, défendant pourtant des visions du monde opposées, se sont mis d’accord, en 1946, sur la nationalisation de l’énergie.
On notera au passage qu’un tel fonds permettrait de répondre aux arguments standards contre une “taxe Zucman”. Taxer les plus aisés, dit-on, détruirait l’investissement. Or, il s’agit précisément ici d’investir dans les secteurs où nos économies sous-investissent chroniquement, au détriment de notre futur. Un fonds souverain écologique permettrait donc de dégager des ressources clefs pour les entreprises stratégiques du secteur de l’éolien, de la batterie électrique ou de la mobilité bas carbone. Trop d’entreprises dans ces secteurs peinent aujourd’hui à se financer sans passer par l’étranger.
Mais ne risque-t-on pas de confier ces décisions à une bureaucratie éloignée des réalités de terrain ? Ce risque existe, comme pour toute institution, et il impose une exigence forte sur la gouvernance. Pour fonctionner, un tel fonds doit être doté de règles claires, d’une gouvernance efficace, transparente et démocratique, et capable d’attirer expertises et talents. Le fonds d’investissement Norvégien, le plus grand au monde, montre que cela est parfaitement possible.
Soulignons enfin qu’un fonds souverain est à la fois un instrument de souveraineté et de justice sociale : en investissant, la puissance publique crée de la richesse collective, appartenant à chacun plutôt qu’à quelques-uns. Cette richesse peut être réinvestie dans la transition ou dans les services publics, au lieu d’alimenter les patrimoines les plus aisés.
Pour conclure, l’Europe est plus que jamais à la croisée des chemins. Soit elle s’engage sur la voie de la vassalisation énergétique, soit elle assume que la transition écologique est un enjeu de contrôle et de pouvoir, qui exige un retour de l’Etat stratège et de l’investissement public dans des entreprises stratégiques. Un fonds souverain écologique européen permettrait d’avancer concrètement dans cette voie.
Lucas Chancel est économiste, professeur à Sciences Po et codirecteur du Laboratoire sur les Inégalités Mondiales. Il est auteur de Energie et inégalités : Une histoire politique (Seuil, 2025).