|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Texte d’Alain Grandjean, docteur en économie de l’environnement, président de The other economy et co- fondateur associé de carbone 4.
Un article de Julien Lefournier paru dans le site de Bon Pote et titré Changer de banque pour sortir des énergies fossiles ? vient de susciter des échanges sur Linkedin. Carbone 4 est mentionné dans une des réponses. Je me permets donc quelques précisions.
1/ Carbone 4 est une entreprise de conseil et de fourniture de données ; nous ne sommes donc que des prestataires de service et non des partenaires de nos clients. Nous nous abstenons de les juger et nous n’avons pas pour vocation, sauf mention expresse explicite, ce qui n’est pas le cas ici, de valider un business model ou une activité.
2/ Nous n’avons pas de conseil à donner aux citoyens sur leur banque.
3/ Sur la question des métriques carbone, comme l’écrit très justement Julien Lefournier, ce sont bien les activités de l’économie réelle qui sont sources de GES. Les acteurs financiers sont des acteurs de second rang en la matière. Leur rôle principal (financement, arrangement, conseil, facilitation, assurance etc.) est donc indirect, ce qui ne veut pas dire nul (un projet réel doit bien être financé et assuré). Par ailleurs, leurs émissions directes – dues à l’informatique, aux bâtiments – sont assez faibles en général.
4/ Il n’est donc pas correct méthodologiquement de mettre sur le même plan les émissions associées à un financement et encore moins à l’épargne financière et celles d’une activité réelle (produire, consommer etc.). Au plan méthodologique, il est évident que l’action d’un citoyen sur son épargne n’est pas de même nature que son action sur son chauffage ou sa nourriture.
5/ L’émission qui résulte de la combustion du charbon par exemple fait intervenir l’exploitant de la centrale, son financeur, l’actionnaire majoritaire, le consommateur de l’électricité produite… Attribuer plus particulièrement l’émission à l’un de ces acteurs repose sur une convention et il y en a plusieurs possibles. Mais on ne peut pas les utiliser simultanément sans créer de confusion, semblable à celle qui est exposée au point ci-dessus. Le terme empreinte carbone devrait être réservé à l’attribution au consommateur pour caractériser son mode de vie : l’empreinte carbone ce sont les émissions de l’ensemble des consommations nécessaires pour le maintenir. Parler d’empreinte carbone de l’épargne ou du compte courant est donc un abus de langage source de confusion. Nous utilisons dans la suite le terme « bilan carbone » pour caractériser les émissions directes et indirectes d’une entreprise (financière – dont bancaire- ou non) nécessaires à son activité.
6/ La question de l’attribution des émissions de GES à un compte-courant ou un dépôt dans une « vraie[1] Une « vraie » banque dispose d’un agrément bancaire, licence délivrée avec parcimonie et sous de nombreuses conditions par la BCE dans la zone Euro et, en France, sur proposition de l’ … Continue reading
» banque pose de nombreux problèmes évoqués à juste titre par Julien Lefournier. Insistons sur le plus important : il n’y a pas de fléchage entre le passif et l’actif d’une banque. Les émissions « financées » par une banque, telles qu’on peut les évaluer dans son bilan carbone[2]Qui inclut aussi les émissions issues de son activité de conseil ou d’arrangeur.
sont calculées à partir de son actif et pas de son passif. On ne peut pas les attribuer à un élément spécifique de son passif. De la même manière, il n’est pas possible d’attribuer les émissions d’une entreprise de manière indiscutable à un élément spécifique de son financement, même fléché ou dédié[3]Comme des financements immobiliers, ou d’actifs comme des avions, des trains, des flottes de véhicules. C’est la plupart du temps, parce qu’ainsi la banque bénéficie d’une garantie … Continue reading
. Comme le rappelle la parabole du manteau de vison de Claude Riveline, citée dans l’article de Julien Lefournier, une entreprise voit arriver sur son compte bancaire tous ses financements, qui lui servent à financer l’ensemble de ses projets et des actions qui lui sont nécessaires (achats, personnel et autres) dont les émissions sont comptabilisées dans le bilan carbone.
C’est la même chose pour une banque, qui a en plus le pouvoir de création monétaire ce qui rend l’attribution au passif collecté encore plus discutable (la création monétaire génère un compte courant, ex nihilo, mais qui ne naît que parce qu’il est contrepartie d’un actif, un prêt bancaire le plus souvent).
7/ Une « néobanque » n’est en général pas une banque mais un prestataire de services financiers ; elle est adossée à une banque. Son activité de collecte de l’épargne des ménages sur son compte-courant est un service commercial pour le compte de cette banque. La remarque précédente s’applique donc à elle, même si elle prétend que ces comptes courants sont affectés à des projets dénommés et cantonnés. Elle ne peut faire mieux au plan du carbone que sa banque d’adossement.
Références[+]
| ↑1 | Une « vraie » banque dispose d’un agrément bancaire, licence délivrée avec parcimonie et sous de nombreuses conditions par la BCE dans la zone Euro et, en France, sur proposition de l’ ACPR. Cette licence permet de collecter des dépôts, d’accorder des crédits et de réaliser les diverses opérations d’une banque. Seules les banques ont le pouvoir de création monétaire. |
|---|---|
| ↑2 | Qui inclut aussi les émissions issues de son activité de conseil ou d’arrangeur. |
| ↑3 | Comme des financements immobiliers, ou d’actifs comme des avions, des trains, des flottes de véhicules. C’est la plupart du temps, parce qu’ainsi la banque bénéficie d’une garantie spécifique, plus facile à exercer. |
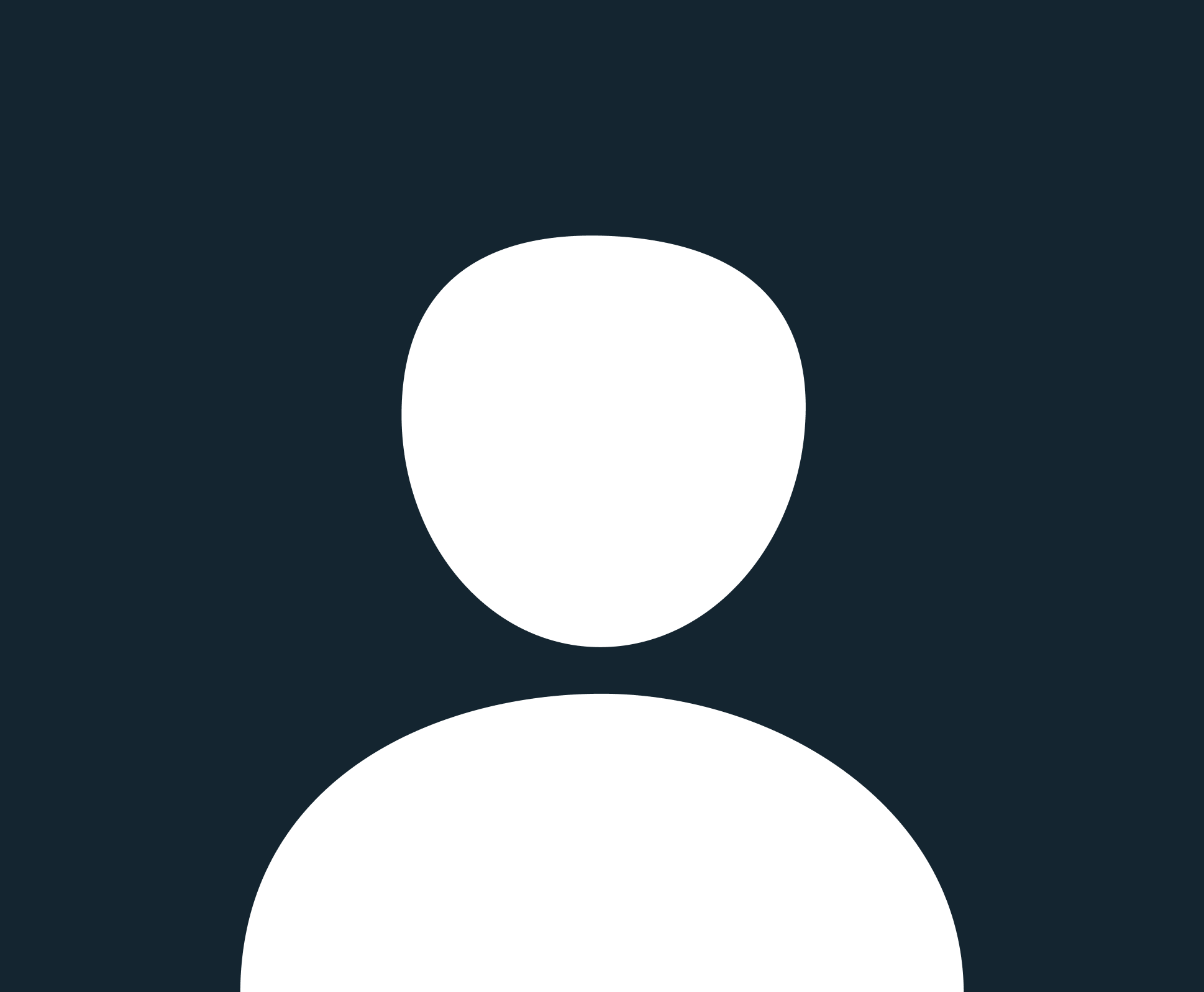


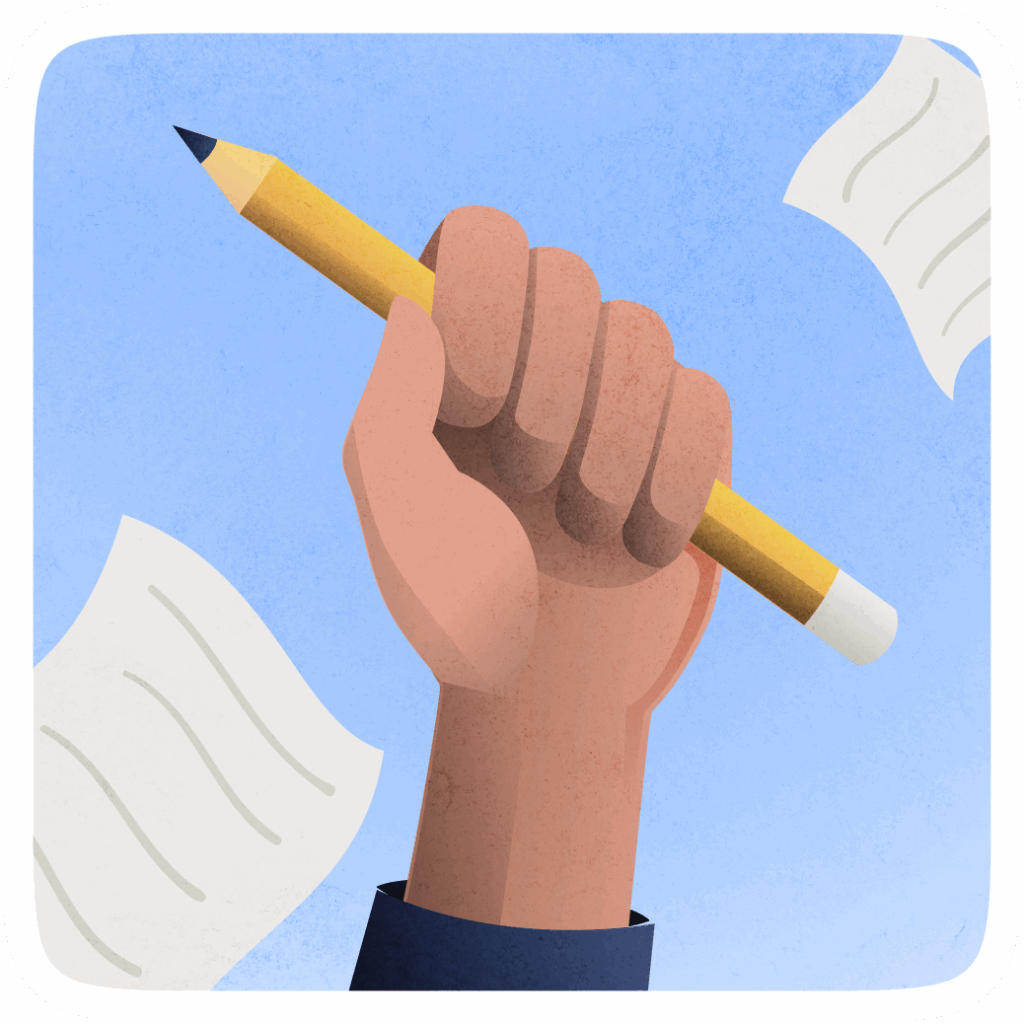

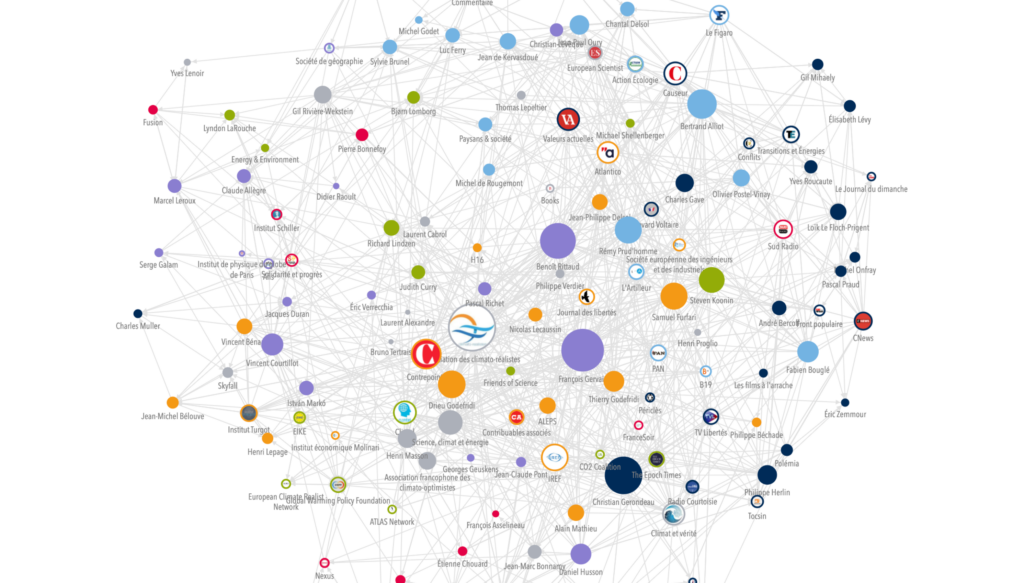







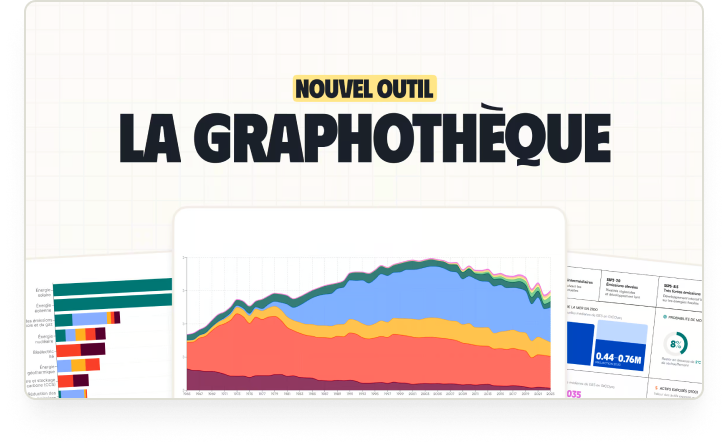
5 Responses
Il ne faut pas changer de banque, il faut sortir du système bancaire car il est globalement néfaste.
Certaines cryptomonnaies sont bien pour ça (BTC ou XMR par exemple).
Merci beaucoup pour ses échanges et @le bon pote pour vos articles. Je serais du côté de Polent de dire quel était le but de cette article. Et je trouve aussi qu’il apporte plus de confusion. Ce qui important pour moi est l’éthique de la banque et des banques comme HSBC, Barclays et NatWest ont des valeurs aux quelles je ne suis pas alignée. Maintenant j’ose croire qu’investir dans des fonds impacts ou climatiques aura un impact sur le futur et aussi dans l’idée qu’investir dans ces domaines deviendra plus intéressant que dans les projets contre le bien être de notre planète.
Bonjour,
Merci pour cet article. Il est intéressant du point de vue intellectuel mais je ne suis pas convaincu qu’il apporte en l’état de la clarté à l’audience quant aux chemins à prendre pour participer à faire bifurquer l’économie et la société.
1) Le critère de l’agrément bancaire est hors sujet climatique, et pourtant un point saillant de ces deux articles
Cet article, comme le précédent, semblent avoir parmi leurs messages clés de discréditer les fintech au profit des établissements disposant d’un agrément bancaire, ce qui ne me semble pas fondé du point de vue des enjeux climatiques. Je suis un lecteur avide de BonPote pour son éducation populaire aux enjeux d’habitabilité du monde. Pas pour discréditer des entreprises sur un critère sans incidence de ce point de vue.
2) Il me parait important de ne pas laisser entendre que BNP/SG/CA = GreenGot/Hélios
Dans le contexte relativement polémique de ces deux articles, j’appelle à la plus grande prudence quant au choix des mots.
Par exemple, écrire qu’une “[néobanque] ne peut faire mieux au plan du carbone que sa banque d’adossement” expose le risque que cette phrase soit reprise pour justifier que GreenGot et Hélios n’ont pas un impact environnemental meilleur que celui de la BPN/SG/CA et autres (et sont donc inutiles). Or, ceci serait erroné. L’impact climatique entre établissements diffère. Cet article ni le précédent n’apportent pas cet éclairage, et cela me parait dommageable.
3) La clarté repose sur la cohérence
Par ailleurs, pour apporter de la clarté, il est préférable d’être cohérents sur ses différents canaux de communication, et je me permets donc de donner de la lumière à des publications contradictoires chez Carbone4 et BonPote :
Chez Carbone4 :
– “Choisir sa banque et placer son argent est 1 des 4 leviers principaux pour faire sa part dans la transition bas carbone. […] L’impact carbone des comptes courant vient principalement du fait que les dépôts augmentent la capacité d’octroi de prêts des banques, dont les politiques de financement sont plus ou moins vertueuses pour le climat.” (https://www.carbone4.com/analyse-decarbonation-compte-courant)
Cet article de Carbone4 semble être contradictoire avec l’article sur cette page du co-fondateur de Carbone4.
Du côté de BonPote :
– “Le choix de la banque pour votre épargne a un impact : il est évidemment bien pire d’avoir son épargne chez BNPP qu’au Crédit Coopératif”
(https://bonpote.com/comment-calculer-son-empreinte-carbone/)
Un message clé dans cet article de BonPote semblait donc d’inciter à changer de banque. Dans l’article de Julien Lefournier, on envoyait un message inverse : “une perte de dizaines de milliers de comptes n’aura pas d’impact significatif sur les grandes banques”.
– le calculateur d’impact de l’épargne que met en avant BonPote au travers de ses pages : https://futur.eco/simulateur/finances/mon-épargne
4) En conclusion, diffusons les messages les plus clairs, pertinents et incitant à l’action possible
Au travers de ces deux articles, ce florilège “d’arguments”, pertinents ou non au regard du climat, parfois rédigés (volontairement ou non) avec une confusion entre les produits d’épargne et les comptes courants, semble avoir pour cible les “néobanques”, incite à l’inaction, et ne me semble pas permettre d’informer utilement les populations face aux enjeux climatiques.
J’ai l’impression ici d’assister, impuissant, au même débat généralement stérile entre nucléaire et renouvelable, pendant que l’on laisse les énergies fossiles en place.
Ceci me semble donc dangereux selon les mêmes ressorts que ceux du brouillard informationnel des acteurs pro-fossiles ou pro-tabac. Je ne préjuge aucunement de l’intention, mais donne ici mon sentiment à la réception et lectures (désormais multiples) de ces deux articles.
–> Ne perdons pas de vue nos objectifs, et travaillons ensemble continuellement à la clarté et à la portée de nos messages.
Une fois encore, merci à BonPote pour son engagement. BonPote.com regorge d’articles de grande qualité.
Merci pour ces précisions ! Mais dans ce cas là, pouvons nous faire un récapitulatif plus holistique ?
1) Est-ce qu’il y a quoi que ce soit de positif, ou négatif, si UNE personne change de “banque” pour aller chez une banque qui se veut verte ?
2) Et dans le cas où il y a, je sais pas, 100.000 personnes qui vont vers cette banque “verte” ?
Est-ce que à grande échelle, cela peut mener à davantage d’actions positives pour l’environnement si ces banques qui se veulent vertes ont plus de clients ? Peut-être que ça donnerait plus de poids politique à leurs “bonnes intentions”?
Et à l’inverse, s’il y a exode et départ en masse de clients qui quittent une banque polluante, est-ce qu’il y aurait une possibilité de dégâts en moins sur l’environnement ? Peut-être car cette banque aurait plus de mal à avoir la confiance d’autres grosses structures ?
Bref, pour moi maintenant c’est clair que beaucoup d’arguments des néobanques sont très vacillants, mais concrètement, est-ce juste totalement inutile d’aller vers elles ?
Merci !
La distinction des responsabilités entre les entreprises, leurs actionnaires majoritaires et les autres financeurs est effectivement importante.
Tous les financeurs ont une responsabilité, mais le majoritaire et le management ont un rôle prépondérant. (En cohérence avec ce propos notre fonds de decarbonation, toujours majoritaire, assume 100% des émissions des entreprise dans lesquelles il investit).
Ce n’est pas le principe actuel de la SFDR, qui répartit les émissions sur tous les financeurs au prorata des capitaux. À reconsidérer dans le futur, à mon avis.